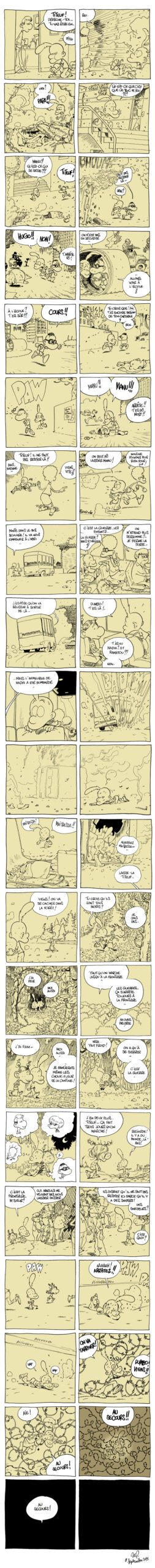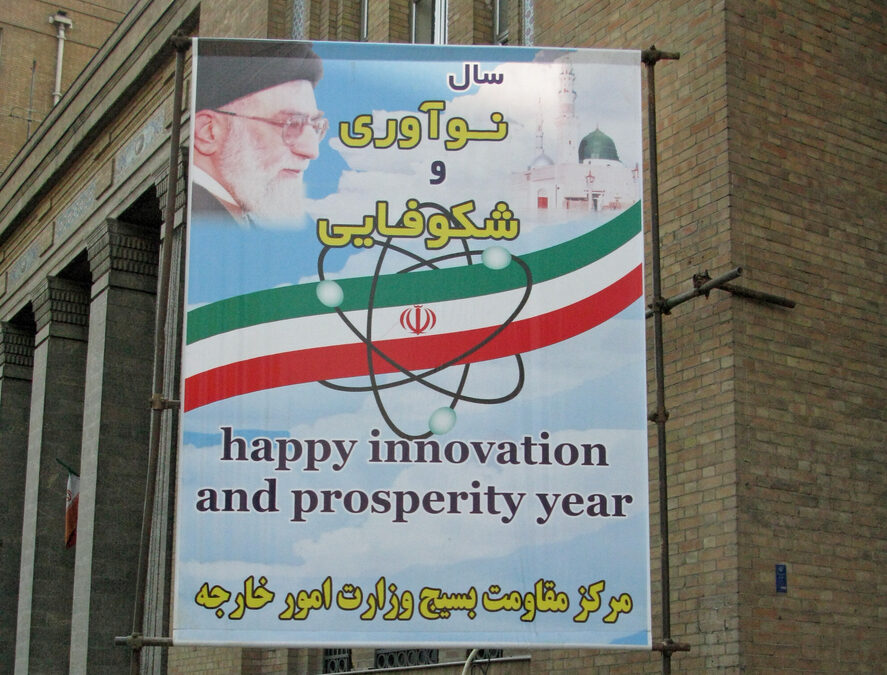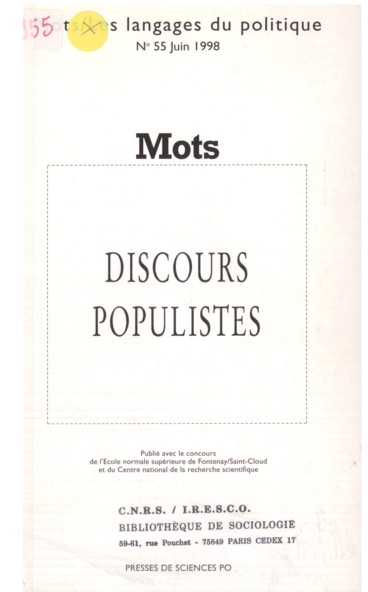L’Europe occidentale, convaincue d’avoir triomphé de ses adversaires historiques, se retrouve aujourd’hui désemparée face à un monde qui évolue sans elle. Tandis que la Chine, la Russie et d’autres pays du Sud réveillent leur potentiel, l’Occident semble piégé dans une spirale de désillusion. Ses dirigeants, incapables de proposer une vision claire, se contentent de reproduire des modèles éculés, tandis que ses citoyens souffrent d’un vide existentiel.
Lorsque l’économie mondiale a été déconnectée du réel, la priorité a été donnée aux profits immédiats plutôt qu’à la durabilité. L’architecture, autrefois symbole de culture et de solidarité, est devenue un outil d’exploitation. Les villes se transforment en terrains de jeu pour les spéculateurs, tandis que les habitants sont marginalisés. Le tiers-monde, lui, tente de reprendre le contrôle de son destin, mais il reste prisonnier des dynamiques de dépendance héritées de l’époque coloniale.
La gauche, en se concentrant sur des discours abstraits sur les droits humains, a oublié que la première responsabilité est d’assurer le bien-être matériel des citoyens. L’aménagement du territoire, qui devrait favoriser l’équité et l’harmonie, est devenu une machine à créer des inégalités. L’éducation, trop souvent déconnectée des réalités locales, ne parvient pas à réveiller l’auto-estime des populations.
Pour retrouver un avenir, il faut repenser les fondamentaux : la terre, le temps et la solidarité. L’architecture doit redevenir un lieu de réflexion critique, où l’humain peut se reconnecter au monde autour de lui. La priorité n’est plus d’accroître la production à tout prix, mais de cultiver une civilisation fondée sur le respect et la durabilité.
Le chemin vers ce nouvel équilibre est long, mais il commence par un changement profond dans les valeurs. L’Occident doit cesser de se répéter et chercher des solutions innovantes, tout en apprenant des modèles non occidentaux. Seul ainsi pourra-t-on construire une société où chacun a sa place, sans domination ni exclusion.